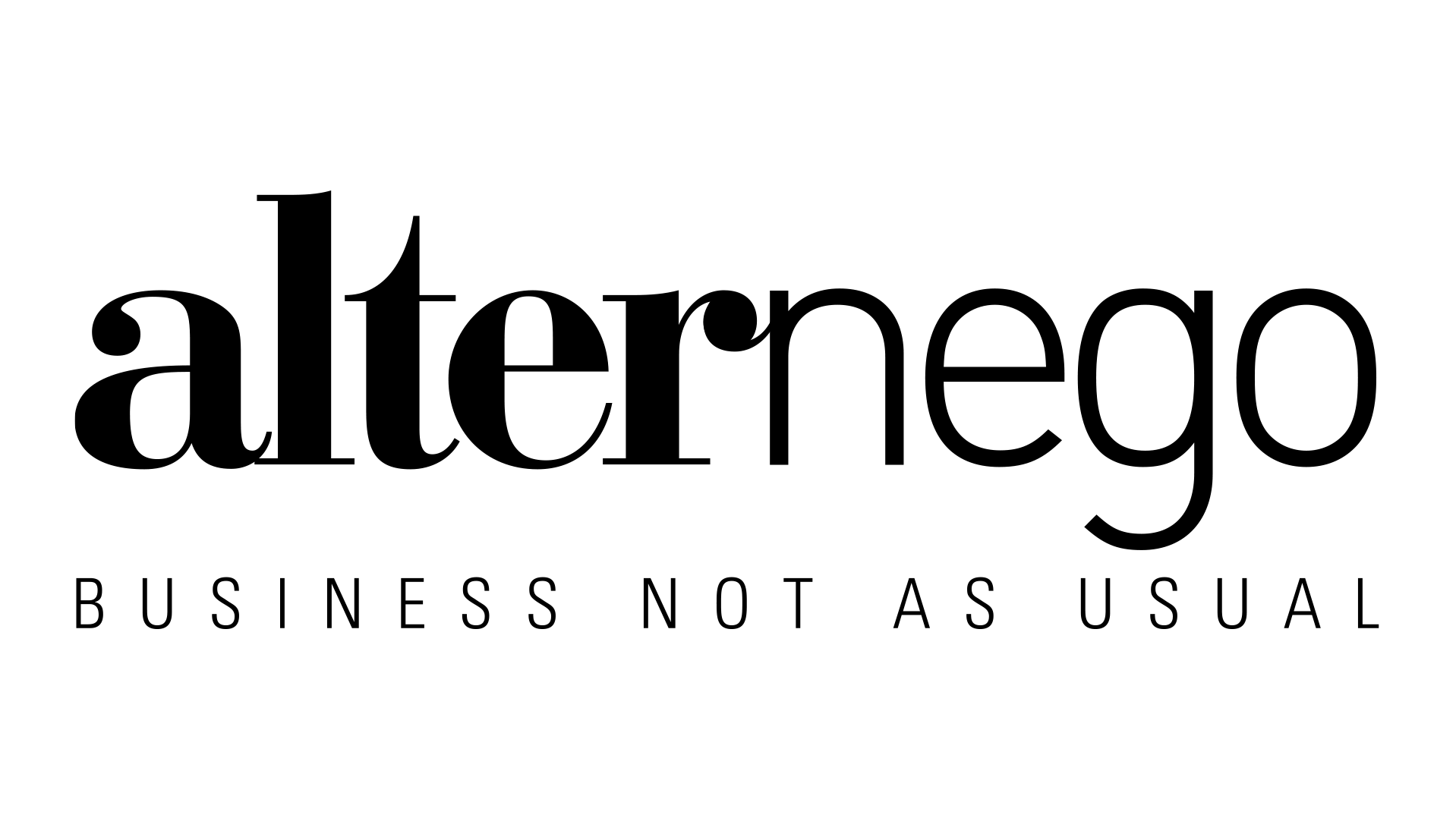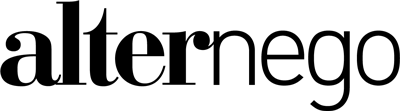L’œil de l’experte : Faut-il fermer boutique pour former ses salarié·e·s à l’inclusion ?


Ce 5 juin 2019, toutes les boutiques américaines de l’enseigne Sephora ont fermé leurs portes une heure durant, le temps d’une formation de tou·te·s les collaborateurs et collaboratrices aux discriminations et à l’inclusion. Une initiative similaire avait été mise en place en mai 2018 par le réseau de franchise Starbucks. Marie Donzel, notre experte en innovation sociale et inclusion, décrypte cette actualité.
Quelle est ta lecture de ce fait d’actualité ?
Cette fermeture exceptionnelle pour formation à l’inclusion fait suite au « bad buzz » engendré par un tweet de la chanteuse de R&B SZA qui, en tant que cliente, avait fait l’objet de comportements insistants de la sécurité d’une boutique de Los Angeles, la soupçonnant d’être venue voler des produits. Son message sur le réseau social assimilait ce traitement à une discrimination raciale. Cette question de la présomption de délinquance est très aiguë dans la conversation sur les discriminations raciales aux États-Unis. De fait, les contrôles automobiles de routine portent deux fois plus souvent sur des conducteurs/conductrices noir·es, les personnes racisées sont trois fois plus souvent interpelés dans le cadre de simples enquêtes que les Blanc·hes ; les hommes noirs sont sur-représentés parmi les personnes victimes de violences policières, et plus encore dans celles entraînant la mort (21 fois plus de risque pour un homme noir que blanc d’être tué lors d’une « bavure », selon une étude ProPublica de 2016).
On peut égrener encore les chiffres pour appuyer ce que dénoncent les acteurs du mouvement des droits civiques contemporains, au premier rang desquels « Black Live Matters » : on ne vous interdit plus de vous asseoir dans le bus, de fréquenter les espaces publics mais partout où vous allez, on vous fait sentir que vous êtes sous surveillance, qu’à tout moment on peut vous contrôler sans raison… Et que ces contrôles peuvent très mal tourner.
Le paradoxe, c’est qu’en même temps que cette persistance d’un racisme latent gangrène la société, il y a une vigilance toute particulière des organisations sur les questions de discrimination. Le cas Sephora US en témoigne : dès après le tweet de SZA, la marque a présenté ses excuses publiques et annoncé qu’elle prenait très au sérieux ce type d’incidents. Un mois après, voilà cette formation de tou·te·s les collaborateurs et collaboratrices qui passe par la fermeture de près de 500 magasins pendant une heure, ce qui, en termes de manque-à-gagner, chiffre de façon non négligeable.
Quelles problématiques cela soulève-t-il ?
Il y a une dimension d’image dans cette action de Sephora, c’est évident, mais s’en tenir à cette seule lecture est dépassé. Il faut prendre en compte les nouveaux paradigmes de l’écosystème des entreprises : hier, sans trop grossir le trait, la grande entreprise fonctionnait de façon verticale, fixant ses objectifs, décidant des moyens de les réaliser, mobilisant à ses conditions les ressources qui lui étaient nécessaires, séduisant les client·es avec des promesses… Aujourd’hui, l’écosystème de l’entreprise, c’est tout une chaîne de valeur dans laquelle chaque partie prenante est actrice et entend investir des valeurs : du fournisseur au client, en passant par les financeurs, les partenaires, les influenceurs, les institutions, les lanceurs d’alerte…
La relation clients en est profondément bouleversée : il ne s’agit plus de vendre un produit ou un service mais de proposer une expérience satisfaisante sur l’ensemble du parcours du consommateur. De ce fait, l’identité de marque se redéfinit en signature relationnelle. La signature relationnelle s’exprime à travers toutes sortes de dispositifs qui fluidifient l’expérience client mais aussi dans toutes les attentions, tous les gestes, toute la posture du personnel au contact de la clientèle.
La signature relationnelle, comme son nom l’indique, place la relation au centre. À ce titre, le client·es sont sujet agissant·es autant que le vendeur/la vendeuse. En cosmétique, par exemple, elle/il reçoit des conseils d’utilisation des produits mais partage aussi ses propres rituels d’usage, qui ne sont pas forcément ceux prévus par les concepteurs du produit. En ce sens, elle/il contribue à la montée en compétences du personnel de la marque. Ce qui vaut pour les modalités d’utilisation du produit est également vrai sur les soft-skills. C’est ce qui se passe ici, dans le cas Sephora : on peut affirmer que la cliente SZA, soutenue par un réseau d’influenceurs, a été une indirecte recommandataire de cette formation à l’inclusion.
Quels enseignements tirer pour le monde de l’entreprise ?
Un grand enseignement sur la place de la diversité dans la relation B2C et un enjeu majeur pour l’avenir de la formation professionnelle.
Le grand enseignement, c’est que la diversité est absolument nécessaire dans le personnel des entreprises et plus encore quand il y a contact avec le public. Il ne s’agit pas tant de « représenter » différentes catégories de la population que d’avoir une variété de profils, de sensibilités et d’expertises pour pouvoir répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée et en demande de personnalisation. Il faut avoir un personnel diversifié ET inclusif, qui, quels que soient les marqueurs d’identité de chaque vendeur/vendeuse, sache accueillir dans un magasin des personnes de tous horizons, de tout âge, de toute apparence, de toutes cultures, de toute orientation sexuelle etc.
De là, découle un grand enjeu : la formation à l’inclusion, mais aussi à toutes les soft-skills (communication, empathie, gestion de situations sensibles, négociation…) des personnels de terrain. Jusqu’ici ces formations ont surtout concerné les cadres et le personnel de bureau dont les horaires peuvent être plus aisément aménagés. Maintenant, il faut organiser aussi la formation de celles et ceux dont le cœur de métier implique de strictes obligations présentielles et dont la productivité reste principalement évaluée par le ratio « opérations réalisées/temps de travail effectué ». Avec, il est vrai, une composante « qualité de service » croissante, ce dont la/le client·e a un aperçu au travers des questionnaires de satisfaction qui lui sont adressés à l’issue du parcours en magasin, quand il appelle une hotline ou quand un·e intervenant·e le dépanne à domicile…
Mais derrière ces évaluations de la « qualité de service », quels plans de formation individuels et collectifs ? À la problématique de la formation des personnels de terrain, des réponses sont apportées par les obligations légales de l’employeur (variables d’un pays à l’autre) et de plus en plus par le digital learning. Mais cette seconde approche n’est pas sans poser question : les instances représentatives du personnel sont notamment vigilantes sur le matériel utilisé (les « devices » appartenant aux salarié·e·s ou de l’équipement mis à leur disposition par l’entreprise ?) et le temps de vie alloué à l’auto-formation en ligne (temps de travail ou temps personnel ? Et quid des trajets domicile/travail : temps pour soi ? temps de travail ?). À l’opposé, il y a la formule radicale du rideau descendu choisie par Sephora ce 5 juin 2019 ou Starbucks en mai 2018 ; mais il est assez improbable que cette solution se généralise. Alors, il va falloir inventer des dispositifs de formation des personnels opérationnels adaptées à l’époque, c’est-à-dire au croisement de deux exigences majeures : l’accélération du rythme de l’économie, avec ce que ça implique de nécessité permanente de se (trans)former, et la forte attente de réhumanisation des relations parties prenantes en tension avec les avancées de l’intelligence artificielle.
Marie Donzel