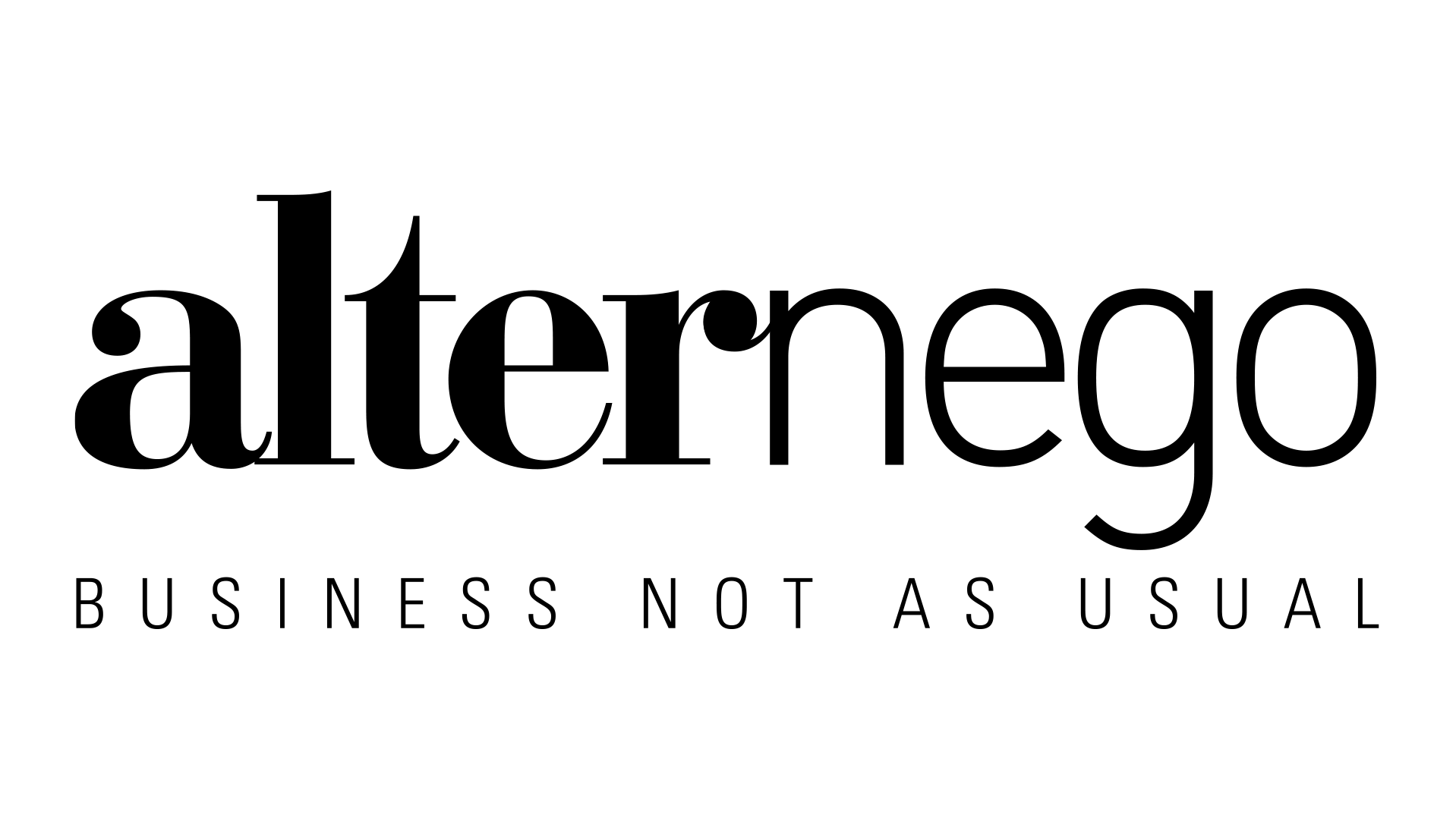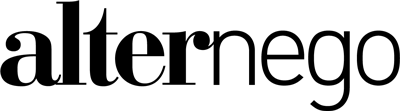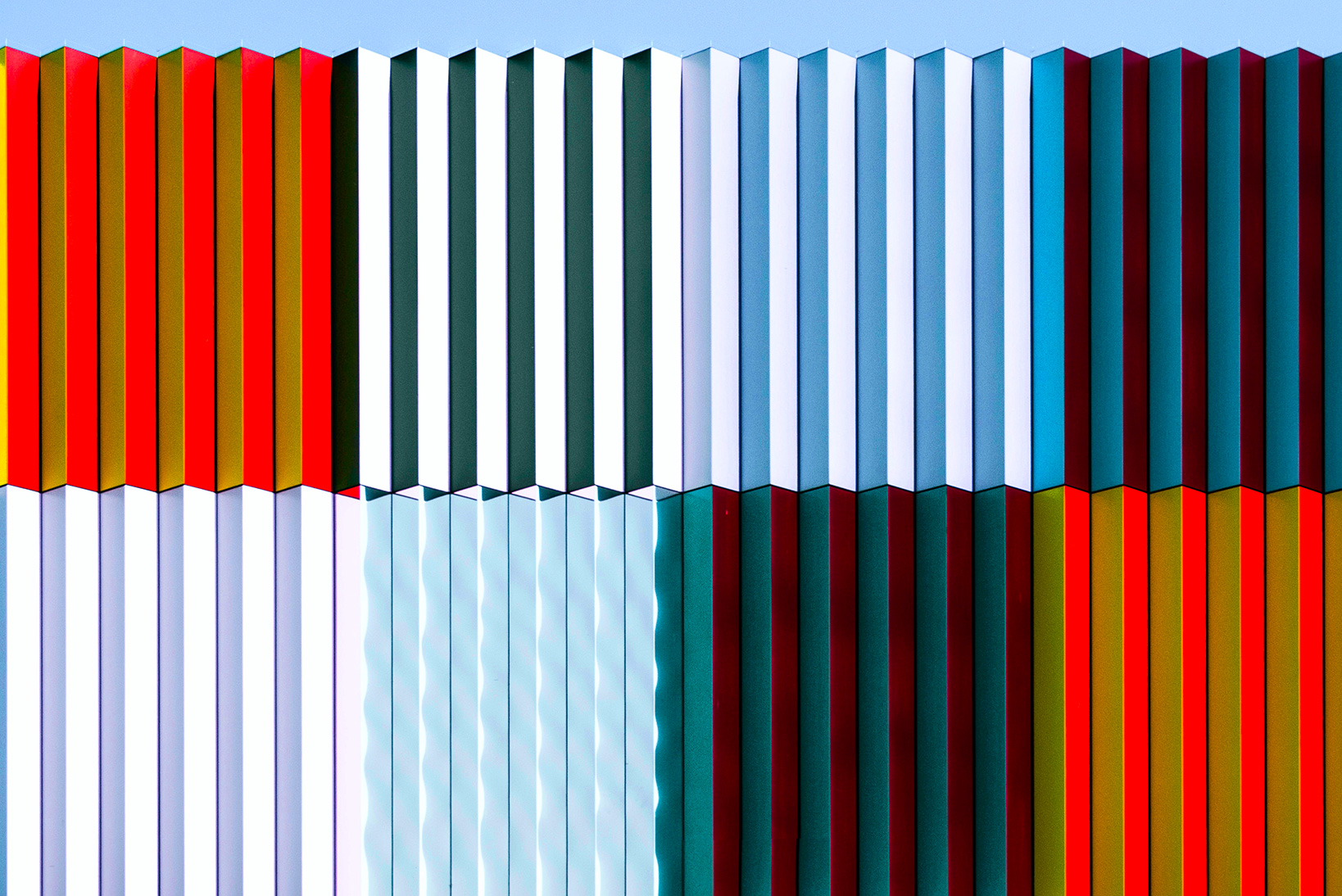Ça, c’est de l’innovation sociale !
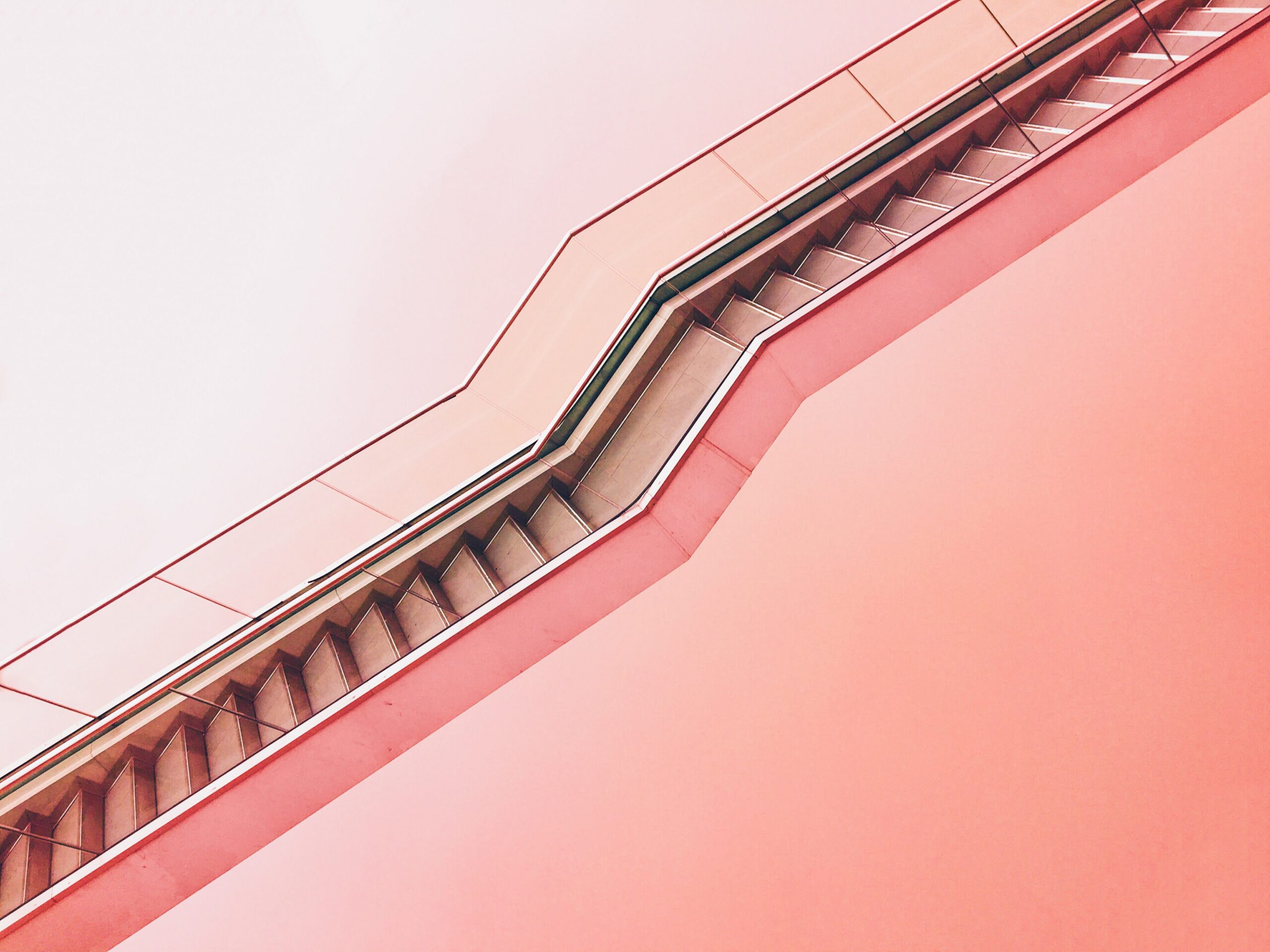
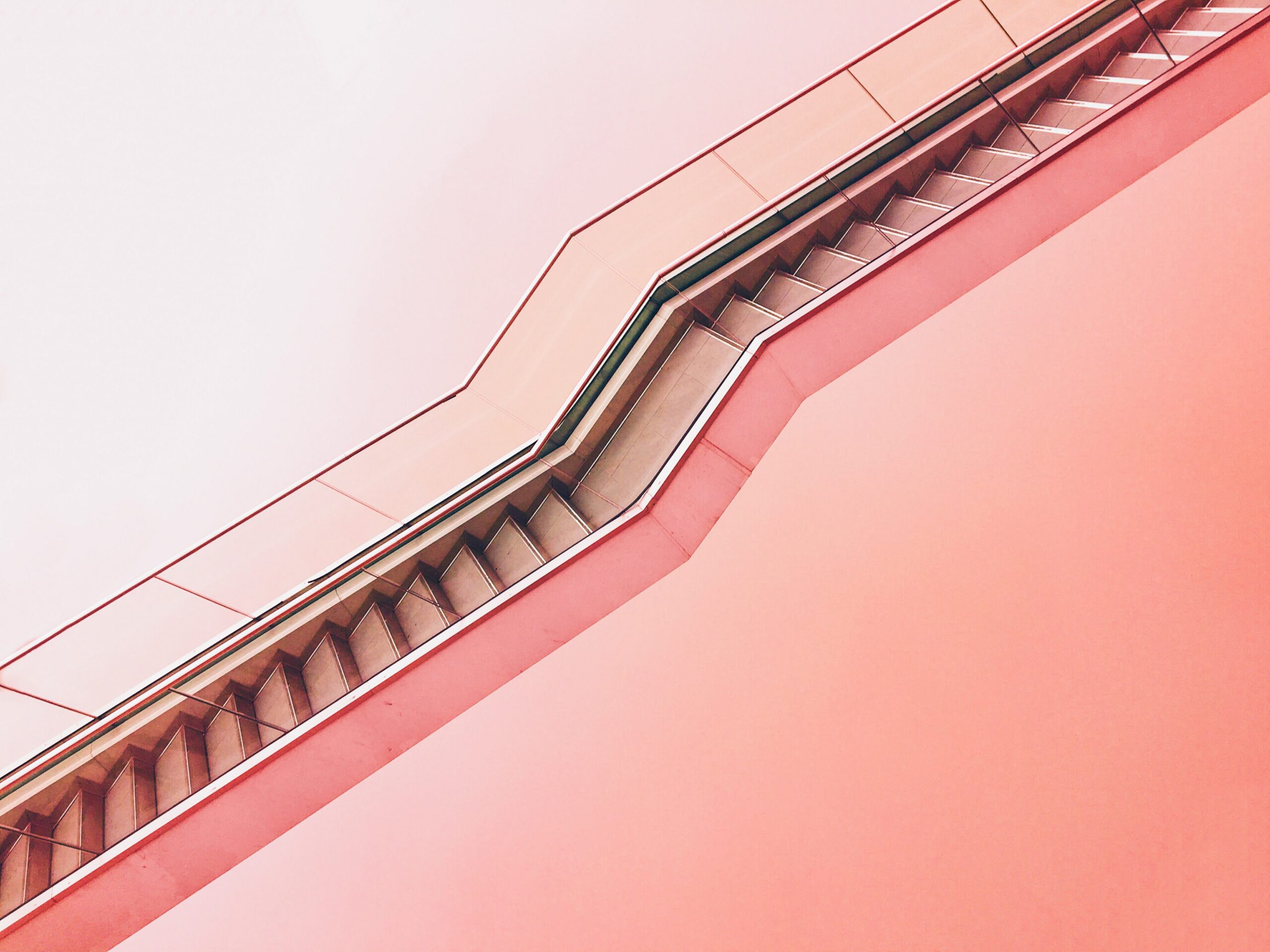
L’innovation sociale, c’est l’affaire des structures de l’ESS ? Oui mais pas que ! Les entreprises « classiques » en font aussi (parfois sans le savoir ou sans le nommer ainsi) et elles ont tout intérêt à en faire davantage.
L’innovation sociale et environnementale consiste à changer les règles du jeu pour produire de la valeur, financer des projets et distribuer les richesses autrement que dans les modèles économiques principalement guidés par la performance financière.
Comme pour toute innovation, l’innovation sociale et environnementale se concrétise à travers des initiatives qui resteront isolées, d’autres qui passeront à l’échelle et puis certaines qui disrupteront un marché, rendant littéralement obsolètes des façons de faire qui pourtant nous semblent aujourd’hui indépassables. L’innovation sociale est le fruit de « projets à impact », relevant du secteur de l’ESS, mais c’est aussi le produit d’initiatives d’organisations de l’économie dite « classique ». Voici quelques exemples.
Le travail bi-localisé : une idée pour concilier les temps de vie.
Dès 2011, c’est à dire bien avant la crise COVID, SNCF se penche sur les nouvelles attentes en termes d’organisation du travail. Le sujet est bien posé : il faut à la fois répondre à la problématique de l’allongement des trajets domicile- travail (avec ce qu’ils représentent de pénibilité et d’impact carbone) et veiller à ce que le télétravailleur ne souffre pas d’isolement. Un pilote de « travail bilocalisé » est mis en place : les salariés pourront aller travailler dans la gare la plus proche de chez eux où des postes de travail sont aménagés pour les accueillir en contrepartie d’aide. en gare aux heures de pointe en cas de nécessité.
La crise sanitaire a vu des initiatives de ce type fleurir dans de nombreuses organisations, pour permettre à des salariés de rejoindre un lieu professionnel garantissant des conditions respectueuses de la QVCT et favorables à la coopération et à la convivialité au travail sans pour autant devoir se rendre quotidiennement dans l’espace présentiel de référence. Aujourd’hui, avec l’appui de structures comme 1km à pied, certaines entreprises œuvrent à rationaliser l’ensemble des trajets domicile-travail de leur effectif, en tâchant de proposer dès que c’est possible à tout salarié le poste adapté à ses compétences implanté au plus près de son lieu d’habitation.
La pair-aidance : quand la santé devient un enjeu collectif.
Longtemps, le pouvoir médical a été entre les mains des médecins. Dès les années 1970, des collectifs de patients s’organisent pour partager l’expérience de la maladie, des traitements, de la guérison. Et ça porte des effets très positifs : le soutien entre pairs apporte une précieuse aide psychologique qui améliore sensiblement la qualité de vie des malades et leur pronostic de rétablissement. Mais les patients ne se donnent pas que du courage, ils partagent aussi une foule de conseils pratiques tirés de leur expérience pour mieux gérer la douleur, mieux supporter les traitements, limiter les effets secondaires. La pair-aidance se développe considérablement dans les années 1990 avec l’épidémie de SIDA. Elle est aujourd’hui considérée comme un maillon essentiel dans le protocole de soins pour des maladies chroniques physiques ou mentales (en particulier les addictions).
Elle se déploie sous d’autres formes dans le monde du travail, au travers notamment des communautés au sein des entreprises, où l’on peut partager un vécu (par exemple de personnes appartenant à une minorité) et porter une voix pour proposer des transformations qui s’avéreront souvent utiles à tous (par exemple, les réseaux de femmes ont porté dans les années 2010 le sujet de l’articulation des temps de vie, dont on cerne bien aujourd’hui qu’il concerne tout le monde et relève bien plus de la QVCT que de la mixité).
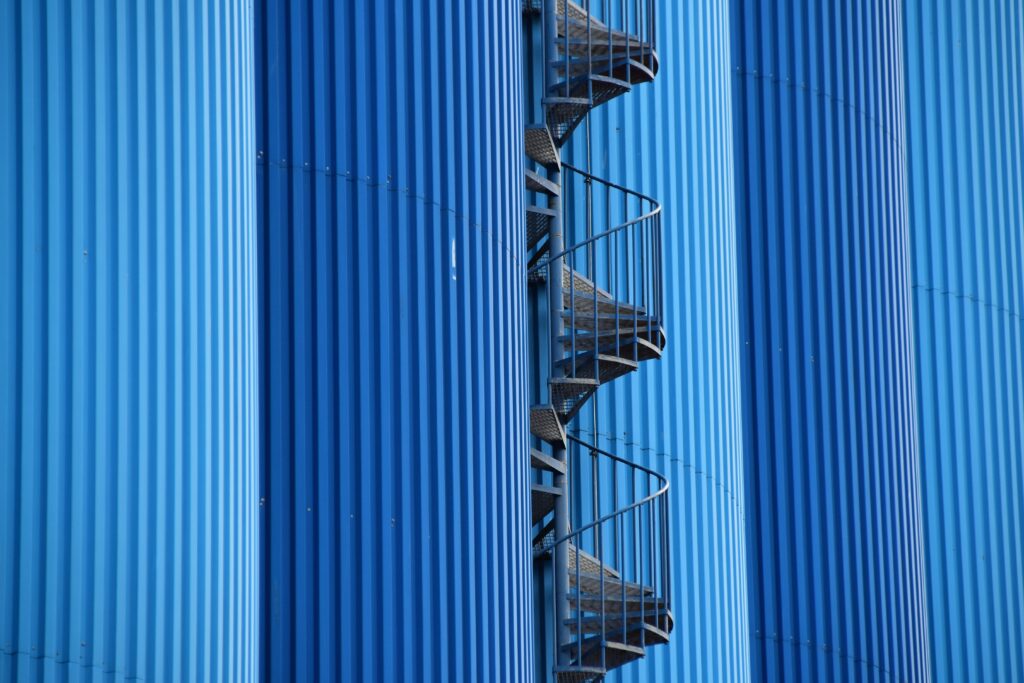
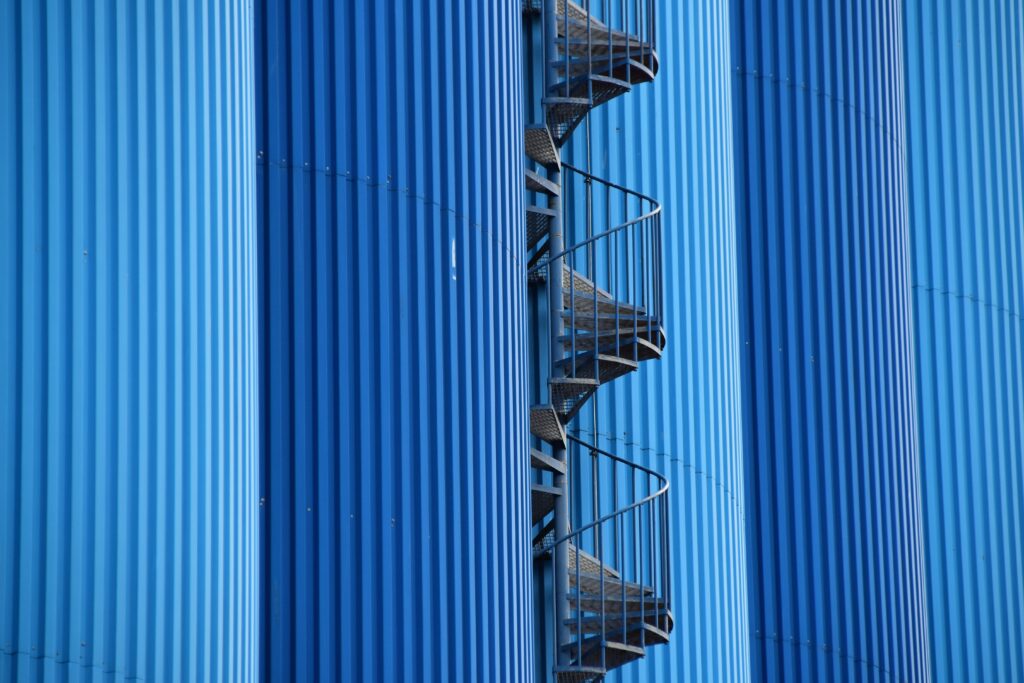
Le partenariat de performance fournisseur : passer de « cost-killer » à «soft-skiller ».
Il y a plusieurs façons de pratiquer les « achats responsables » en vue d’élaborer une chaîne de sous-traitance la plus respectueuse possible des équilibres sociaux et environnementaux. La plus simple consiste à imposer des critères discriminants, écartant du sourcing des fournisseurs toute entreprise qui ne respecterait pas la parité dans son codir, ne témoignerait pas d’un taux donné de réduction de ses émissions carbone, ne fabriquerait pas l’ensemble de ses produits en Europe… L’avantage de cette solution : elle permet assez facilement à l’entreprise commanditaire d’avoir une chaîne de valeur propre. L’inconvénient : elle laisse de côté toutes les entreprises qui n’ont pas les moyens de se transformer et les auront encore moins si on les prive de commandes. Alors, on peut aussi décider, quand on est un donneur d’ordre significatif, d’aider ses fournisseurs à monter en maturité sur les sujets environnementaux et sociaux. Concrètement, on adosse au contrat-cadre une convention de partenariat de performance RSE qui établit un certain nombre d’objectifs à atteindre, avec un budget fléché vers des actions prioritaires de transformation.
Ce principe d’effort partagé a pour effets indirects de rompre avec le jeu « pot de fer/pot de terre » traditionnellement pratiqué dans les relations achats et de faire de celui qui était un « cost-killer » un « soft-skiller ».
Le fellowship interentreprises : la diversité des expériences créatrice de valeur.
Au tournant des années 2010, de nombreuses entreprises se trouvent confrontées à une problématique de pyramide des âges. Les boomers, première génération à avoir compté autant de cadres, sont encore en postes tandis que la génération X pousse au portillon. La progression verticale en entreprise est en panne. Ajoutez-y l’enjeu de féminiser l’encadrement supérieur et vous avez dans les entreprises un nombre inédit de personnes de 45-50 ans, compétentes et qui aspirent à prendre des responsabilités, mais auxquelles il va falloir dire d’attendre un peu (enfin, 5 ans ou plus). Frustrant. Et risqué : elles pourraient bien aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte et l’horizon mieux dégagé.


Et si, au lieu de les laisser partir, leur employeur leur offrait un voyage d’échange : tu restes en contrat avec moi, mais tu es mis à disposition d’une entreprise partenaire pendant 3 ans, tu découvres d’autres choses, tu développes de nouvelles compétences et tu reviens ensuite pour prendre, armé de légitimité et de tout ce que tu auras appris, le super poste qui sera (enfin) sur le point de se libérer. Certaines personnes ayant participé à un tel programme de fellowship ne sont pas rentrées, préférant soit poursuivre leur aventure professionnelle dans l’entreprise d’accueil, soit se développer vers d’autres voies. Mais on peut prendre le pari que d’une façon ou d’une autre, ces personnes auraient quitté l’organisation mère. Les personnes qui sont « rentrées », elles, se sont révélées de remarquables leaders, ré-énergisées par l’expérience challengeante et directement enrichies dans leurs pratiques professionnelles de ce qu’elles avaient appris dans cette période de fellowship.
Nous pouvons nous inspirer de ce type d’initiatives pour ouvrir de nouvelles voies aux parcours de mobilité, afin que la mobilité géographique et la mobilité verticale ne soient plus les voies uniques de l’accélération d’une carrière.
L’intrapreneuriat au service de l’innovation.
L’idée de l’intrapreneuriat émerge dans les années 1970 pour répondre à deux questions montantes : comment trouver des relais de croissance via l’innovation en continu et comment donner un cadre propice à l’épanouissement du potentiel créatif des collaborateurs d’une entreprise. Dans « intrapreneuriat », il y a au premier abord une contradiction : faire cohabiter l’appétence au risque et l’ambition capitalistique du tempérament entrepreneur avec l’aspiration à la sécurité en contrepartie d’une cession de la propriété du travail du tempérament salarié. Plus qu’une contradiction, c’est une dialectique au cœur de laquelle est remise en jeu la division capital/travail. De nombreux grands groupes ont mis en place des programmes d’intrapreneuriat ces dernières années (Orange, SNCF, Bouygues, BNP, la Française des Jeux…) selon diverses modalités d’organisation, de partage de la valeur additionnelle créée, d’inscription dans le parcours professionnel du développement intrapreneurial des individus. De très belles innovations sont sorties de tels programmes, pour être « scalifiées » par la suite voire devenir de grands succès industriels (le célèbre Post-it est emblématique).
Mais même quand les réalisations ont des destinées commerciales plus modestes, tous les programmes d’intrapreneuriat témoignent d’impacts manifestes sur le développement des compétences des collaborateurs (notamment sur l’acquisition des postures et savoir-faire de leadership) entre autres effets dynamiques sur la transformation managériale.
Le service privé… ouvert au public, pour retrouver du sens commun.
C’est l’histoire d’une PME industrielle du Grand Est qui a installé sur son emprise des bornes de recharge pour véhicules électriques à destination de ses collaborateurs… et qui permet à tout usager de la ville ou de passage de venir se brancher, à prix coûtant, quand les bornes sont libres. D’autres initiatives privées mises à disposition du grand public se font jour : ici, la navette qui emmène les salariés d’une entreprise de la gare au site de production embarque des citoyens dont c’est aussi le chemin ; là, les invendus de la cantine d’entreprise sont proposés gratuitement ou à prix cassés aux salariés comme à des externes via des frigos connectés…
Rationalisation d’un parc d’infrastructures de transition environnementale, facilitation des mobilités, lutte contre le gaspillage, mais aussi insertion numérique, relations intergénérationnelles : de très nombreuses initiatives du privé prennent encore plus de sens quand elles s’ouvrent sur les besoins de la toute la société et apportent des solutions directement disponibles à une population qui dépasse le seul corps social de l’entreprise initiatrice.
Le prêt bonifié en fonction de l’atteinte d’objectifs RSE ou comment recycler les externalités positives générées.
Par définition, la banque est un acteur de la finance qui s’intéresse d’abord aux critères financiers de la performance. Sauf que les banques sont aussi les distributeurs du carburant de l’économie qu’est l’argent et qu’il est tout à fait pertinent aujourd’hui qu’elles fassent leur part dans l’investissement d’avenir que représente la décarbonation de l’économie, le développement des compétences de la population ou l’inclusion des minorités. Le Prêt à Impact mis en marché par la Caisse d’Epargne en 2020, d’abord pour le secteur de l’ESS puis pour les collectivités et les entreprises prend ce pari du partage du poids financier de la transition environnementale et sociale. Concrètement, le contrat de prêt comporte des objectifs extrafinanciers, qui s’ils sont atteints, font l’objet d’une bonification. En d’autres termes, si l’entreprise témoigne d’un impact réel de ses actions environnementales et sociales, le taux de l’emprunt est revu à la baisse (et donc, la banque reverse à l’emprunteur l’écart entre le taux initial et le taux bonifié). L’entreprise qui a contracté le prêt peut réemployer la bonification à sa guise ou bien la reverser à une association qui poursuit de mêmes objectifs de performance sociale et/ou environnementale dans son écosystème.
De plus en plus d’acteurs de la finance, banques comme fonds en equity, business angels comme sociétés de caution mutuelle et autres distributeurs de garanties et subventions, innovent pour donner un cadre rigoureux à la création de valeur extrafinancière. C’est une avancée majeure pour la transition économique qui doit avancer de conserve avec la transition sociale et écologique.