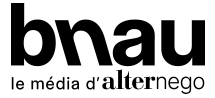Boah
Quand Gaston dit « boah! », c’est qu’il y aurait matière à réagir, à se fâcher, à se défendre, à se mobiliser pour prendre en main une situation, pour rétablir une vérité, pour proposer une idée ou promouvoir une vision, pour réparer une injustice… Mais le jeu semble ne pas en valoir la chandelle. « Boah ! », c’est le bas bruit du découragement et du dépit. À quoi bon se donner du mal puisqu’à l’arrivée, ce sera business as usual. La démission silencieuse est volontiers assimilée à la dépression bureaulière.
Le quiet quitter aurait-il besoin de prendre sa petite pilule journalière pour retrouver le goût de bosser ? Gaston nous répondrait peut-être qu’il se porte bien merci, ce n’est pas lui qui a le moral en berne, c’est plutôt l’organisation qui respire mal, a le ventre ballonné de process ralentisseurs, les articulations du temps rouillées et le cœur au ralenti. Et si du « boah! » des individus qu’on dit « désengagés » montait le cri d’une organisation du travail qui, même nourrie des meilleurs talents, peine à métaboliser?
Taratata
Quand chez Gaston, on dit « tatatata », c’est que non, c’est non et que ça ne souffre pas de discussion. Il y a du « taratata » dans l’air du quiet quitting : les sujets de frustration n’arrivent plus à la table des négociations, pas plus que ne s’expriment des revendications. La résistance par le silence a ceci de confortable pour ceux à qui elle destine son message qu’elle permet le déni. Puisqu’on ne me demande rien, c’est que tout doit aller bien. Évidemment, on se voile la face et on ne se presse pas de réparer la machine-outil la plus indispensable des relations humaines en général et des relations professionnelles en particulier : la culture de la négociation. Pourtant, on en aura tôt ou tard besoin, car les relations se durcissent l’air de rien.
Rogntudjuù
Au début, face au salarié pratiquant le quiet quitting, on a des sentiments plutôt bienveillants. On met ça sur le compte d’un coup de mou. Les jours sans, ça arrive à tout le monde. On ne peut pas être à fond tout le temps. Mais assez rapidement, ça agace. Ça tend un peu le management, ce collaborateur à la Bartleby qui « préfère ne pas » en faire trop. C’est un peu comme avec les gosses qui boudent : dans un premier temps, on apprécie le calme inhérent à la moue bougonne car c’est plus reposant (en apparence) que les colères tempétueuses du gueulard qui se roule par terre. Mais au bout d’un moment, ça plombe l’ambiance. Et puis, ça n’affecte pas que la relation managériale.
Dans les équipes, le sentiment d’inéquité monte : pendant qu’on bosse comme des dingues, y’a des planqués, bien à l’abri de la fatigue et du risque de commettre des fautes, qui lèveraient pas le petit doigt pour donner un coup de main. Si tout se passe comme prévu, le jugement moral s’en mêle et bientôt fusent les noms d’oiseaux (on rappelle ici et à toutes fins utiles que « fonctionnaire » n’est pas une insulte, pas non plus un synonyme de cossard et que le temps de travail réel effectué par les agents de la fonction publique est sensiblement le même que celui des salariés du privé). Y a du « rognrudjuu » dans les rouages.
Mille millions de…
Si vous avez besoin d’arguments sonnants et trébuchants pour vous convaincre de l’urgence d’agir, voici un scoop : le quiet quitting a un coût. Pour le désengagement en tant que tel, comptez 14310 €/an et par salarié, selon l’indice IBET qui agrège des indicateurs de démotivation déclarée, d’absentéisme et de ruptures de contrat de travail pour raisons autres qu’économiques. On y ajouterait bien le coût de la conflictualité au travail en 2021 de 152 milliards d’euros pour la France. Ça représente grosso modo un 1/12e de la masse salariale annuelle versée par les employeurs.
En d’autres termes, un mois de travail de tout le pays gâché, faute d’avoir bien su s’engueuler. Plutôt que de le perdre en souffrance au travail, Gaston verrait sans doute d’un bon œil qu’on l’emploie à produire quelques inventions. Et pourquoi pas carrément à la réinvention du monde du travail. Et pas nécessairement à coup d’outils digitaux réputés, de process plus ou moins kafkaïens ou encore de programme stratégique.
M’enfin
Car « m’enfin », comme aime à s’exclamer Lagaffe quand il est urgent d’effectuer un retour au bon sens, le quiet quitting nous envoie des messages finalement assez clairs.
Premier message : le besoin de clarifier le périmètre du travail. En matérialisant des frontières nettes entre ce que l’on peut ou ne peut pas leur demander, à quelle heure on peut ou non le leur demander, dans quelles conditions ils acceptent ou non de répondre à la demande, les quiet quitters agissent en révélateur d’un excès de porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle mais aussi entre le formel et l’informel, l’implication et le don de soi. Comme le propriétaire qui met des barbelés pour délimiter son terrain si le droit de passage des promeneurs se transforme en invasion de tout son jardin, le quiet quitter ferme la zone de souplesse dans son rapport au travail et à l’employeur. Rendons-lui le pouvoir de donner de soi. Le mot qui compte, c’est donner. Et pour pouvoir donner, il faut s’assurer qu’on ne va pas trop vous prendre.

Deuxième message : le besoin de restaurer de la latence décisionnelle. Ce qui a le plus grignoté le pouvoir de décider des salariés au cours des dernières années, notamment pour ce qui concerne l’organisation de leur propre travail, ce ne sont pas tant les process ou le poids de la hiérarchie, mais l’hypersollicitation et l’hypervitesse. 45% des salariés identifient comme source de stress au travail le manque de temps pour effectuer leurs tâches, et 65% le fait de devoir régulièrement s’interrompre pour effectuer une tâche non prévue (Insee-Dares, 2020). Si l’on considère l’évolution sur une décennie, les deux indicateurs ont connus une croissance de plus de 20 points.
Pourtant Gaston nous l’avait bien dit… « Non aux cadences infernales ! »
Marie Donzel, avec la précieuse relecture d’Elise Assibat