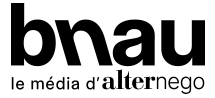Troisième épisode de notre feuilleton consacré à la semaine de 4 jours : où l’on s’interroge sur les effets de la réduction du temps de travail en matière de réduction (ou d’accroissement) des inégalités sociales.
Tous égaux face au « temps libéré » ?
Quand on parle de semaine de quatre jours, il faut aussi s’intéresser aux usages du temps libéré : à quoi occuperons-nous le vendredi si nous n’allons plus taffer ? La question ne se pose évidemment pas dans les mêmes termes pour qui dispose d’un bon capital économique, social et culturel (voire d’une maison de campagne) et pour qui vit avec un budget à l’os dans un territoire faiblement doté en infrastructures de loisirs.
Cette question, qui n’est pas nouvelle, a débouché en 1936 sur la création du sous-secrétariat d’État de Léo Lagrange, ressuscité en 1981 sous la forme d’un éphémère ministère du temps libre, dont la renaissance est à nouveau sur la table des travaux de l’Institut Rousseau en 2023. A chaque fois, la problématique est la même, d’ordre philosophique : peut-on vraiment être libre si on n’a pas les moyens d’exercer sa liberté ?
Travailler moins… Pour travailler plus ?
On peut même pousser le questionnement jusqu’à la dimension biblique en appliquant à la valeur du temps libre le fameux verset de l’Évangile selon Saint-Matthieu : « on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a ».
C’est qu’à l’heure de l’économie de plateforme qui « offre » au travailleur disposant d’heures devant lui la possibilité d’effectuer du travail à la tâche — reviviscence du tâcheronnage du XIXè siècle sous les atours de la modernité technologique —, on ne peut faire l’économie d’une pensée articulant temps de travail et rémunération du travail. A l’heure actuelle, déjà 10 % des 28 millions de travailleurs européens des plateformes sont également salariés. Si on y ajoute la part des micro-entrepreneurs contraints d’adopter le statut pour facturer des petits boulots en complément de leurs revenus d’emploi, force est d’admettre que le multijobbing se développe sur le Vieux Continent. D’aucuns n’y voient aucun mal, arguant avec optimisme de la fluidification du marché du travail et de l’émergence d’un état d’esprit slasheur. Mais il faut savoir raison et décence garder : dans son immense majorité, le multijobbing a le visage de la précarité, de la pauvreté et de l’épuisement professionnel des plus vulnérables.
Ne peut-on pas prendre le pari que sans réévaluation des plus basses rémunérations, la semaine de 4 jours divisera le monde du travail entre ceux qui auront du temps pour travailler moins, se reposer mieux, réseauter plus, s’investir dans des projets valorisants et ceux qui auront du temps pour travailler plus, s’épuiser encore davantage, multiplier les risques professionnels par le nombre de leurs employeurs (comprenant ceux qui sont déguisés en simples « clients » d’une interface de services aux particuliers) ?
Et les inégalités de genre, alors ?
Dans cet épisode de notre feuilleton sur la semaine de 4 jours consacré aux enjeux d’(in)égalités sociales, il nous faut enfin envisager les impacts en matière d’inégalités femmes/hommes.
Dans la configuration d’une semaine de 4 jours sur le modèle 80% de temps de travail payés à 100%, qui correspond de fait à une réévaluation automatique du taux horaire, c’est une bonne nouvelle pour les 3,2 millions de femmes (et 850 000 hommes) à temps partiel qui devraient voir leur rémunération augmenter. Plus généralement, la semaine de 4 jours en version réduction du temps de travail relâche a priori la pression sur le plan de l’articulation des temps de vie. Les plus optimistes parient même sur le fait qu’elle favorisera un meilleur partage des tâches domestiques et familiales puisque les hommes qui bosseraient moins auraient plus de temps pour s’occuper du ménage, des enfants et des vieux parents. Cela ne vaut que si la raison première pour laquelle les hommes sous-contribuent aux affaires du foyer, c’est le fait qu’ils travaillent trop pour l’employeur. Et cela ne marche que si le travail demandé est effectivement calibré pour 4 jours. Sans ça, il se peut que papa ait du boulot en retard à écluser le jour off. Maman aussi, d’ailleurs. Mais l’expérience a montré que si l’un des deux doit sacrifier son boulot pour satisfaire aux exigences familiales, ce sont plutôt les femmes qui y consentent.
En revanche, de la semaine de 4 jours en configuration « 4 journées de 8 heures, 9 heures ou plus », il n’y a rien à attendre pour l’égalité de genre, ni dans les ménages ni au travail. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, il faut s’attendre à ce que celles sur qui reposent 72% du temps de travail domestique et familial en appellent au temps partiel pour seulement pouvoir « concilier les temps de vie », comme on dit. En réalité, ce problème de conciliation n’irait qu’en s’aggravant avec l’allongement de la durée quotidienne de travail : a priori, crèches et écoles n’ont pas pu prévu d’ouvrir plus tôt ou de fermer plus tard parce que les employeurs concèdent une journée off par semaine à celles et ceux qui peuvent commencer avant 9 heures et finir après 19 heures.
Conclusion provisoire : tout sujet d’organisation du travail est une bonne occasion de poser les enjeux de réduction des inégalités… Mais il ne faut jamais attendre d’une modalité d’organisation du travail qu’elle suffise à réduire les inégalités.
***
Demain, dans notre série « 4 jours pour questionner la semaine de 4 jours » : Réinventer le cinquième jour
Lire les précédents épisodes :